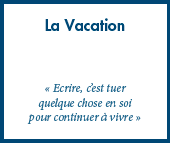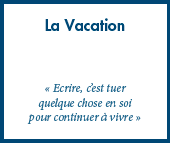Contraception et gynécologie >
DIU ("stérilet") >
Certains gynécologues français s’efforcent de réhabiliter les DIU
Article du 7 juillet 2005
Il y a deux manières d’exercer la médecine : la première consiste à penser qu’on sait mieux que les patient(e)s ce qui est bon pour eux ou elles ; la seconde consiste à partager ce qu’on sait avec ceux et celles qui nous confient leur inquiétude, leur maladie ou leur souffrance, afin de leur permettre de vivre leur vie ou leur maladie au mieux. Bref, ce n’est pas le diplôme ou la renommée qui, à mon humble avis, fait la qualité du médecin, c’est son attitude vis-à-vis d’autrui.
Cette distinction que certains trouveront peut-être "manichéenne" (c’est leur droit) est pour ainsi dire mon seul critère pour qualifier un "bon" ou un "mauvais" praticien.
Je m’appuie en effet sur une idée simple et de bon sens : un diabétologue compétent est celui dont l’objectif est d’aider le patient diabétique à soigner son diabète de la manière la plus autonome possible ; aucun diabétique n’accepterait que son médecin lui dise : "Je ne veux pas que vous vous injectiez l’insuline vous-même, vous le feriez moins bien qu’un médecin ".
De même, il est inacceptable que des médecins disent ou laissent entendre à des femmes jeunes, en bonne santé et dont le niveau d’éducation est chaque jour meilleur, qu’elles sont inaptes à, ou incapables de choisir leur contraception, de comprendre leur mode d’action, ou de décider s’il est bon pour elles d’avoir ou non des enfants au moment où elles le décident.
Contrairement à ce que certains peuvent penser, je ne suis pas "anti-gynécologue", et je ne pense pas que tou(te)s les gynécologues sont incompétent(e)s. Je suis seulement (?!) très critique avec celles et ceux qui refusent aux femmes de choisir les méthodes contraceptives qui leur conviennent, que ce soit par ignorance, par indifférence ou par crainte. Et force m’est de constater, en écoutant ou en lisant ce que racontent les femmes (dans les secteurs où j’exerce ou ai exercés, mais aussi celles qui écrivent à ce site), les médecins (gynécologues ou généralistes) incompétents, timorés ou carrément autoritaires, il y en a beaucoup trop en France. Or, les utilisatrices potentielles de DIU sont encore aujourd’hui celles qui font le plus souvent les frais de ce genre d’attitude.
Mais quand des médecins, gynécologues ou généralistes, tentent de battre les idées reçues en brèche, je suis heureux de souligner la qualité de leur travail... car en ce domaine, les efforts conjugués sont beaucoup plus efficaces que les efforts isolés.
Le 17 juin 2005, j’ai reçu via le site "Gyneweb" (un site français de gynécologues en partie ouvert au public) un lien vers un compte-rendu du 4e congrès de la société francophone de contraception. Ce compte-rendu faisait la part belle aux déclarations de David Serfaty, spécialiste français de la contraception, et visant à lever tous les doutes et tous les préjugés dont souffre le DIU en France. En voici des extraits choisis, car le texte n’est pas encore disponible sur la partie "grand public" du site Gyneweb.
Je ne suis pas d’accord avec tout ce qui est publié sur le site Gyneweb, ni avec tous les points de vue qui s’y expriment. Mais, en l’occurrence, je souscris pleinement à l’effort que font les animateurs de ce site pour diffuser ces informations à leurs membres. Tout ce qui va dans le sens d’une plus grande liberté de choix des femmes, et de la lutte contre les préjugés et les idées reçues sur la contraception, à l’intérieur même de la profession médicale, ne peut qu’être bénéfique pour tous - médecins et patient(e)s.
Note : Le texte publié sur Gyneweb est reproduit en caractères italiques. Les commentaires reproduits en caractères romains sont les miens.
La partie consacrée à la contraception dans le compte-rendu du 4e congrès de la Société Francophone de Contraception rédigé par Christian Rayr, débute ainsi :
Comme le montre l’inquiétante persistance (voire augmentation) des interruptions volontaires de grossesse, en particulier chez les plus jeunes, la « bataille de la contraception » n’est pas encore gagnée... Menée en priorité pour la prévention des grossesses non désirées, elle doit aussi dans le même temps, faire face à l’augmentation des infections sexuellement transmissibles, et en particulier de la plus redoutable d’entre elles. Pourtant, les armes de la panoplie contraceptive ne cessent de s’affûter et de se diversifier : nouveaux procédés, nouveaux modes et schémas d’administration, nouvelles molécules aussi... À tel point que la contraception peut aujourd’hui répondre, à toutes les étapes de l’activité génitale, non seulement à l’exigence de prévention, mais aussi à de nombreuses situations pathologiques qu’elle contribue à améliorer ou contrôler...
« Les adolescentes veulent entendre parler de contraception et de sexualité, estime E. Guibert (Canada) à partir d’une enquête menée dans l’Ontario. Pour prévenir les grossesses à l’adolescence, l’intervention doit être précoce, intense et continue. C’est la leçon des programmes du type ESPAR (éducation sexuelle pour l’action et la réflexion) mis en place au Canada. On doit apprendre à planifier les grossesses « tôt dans la vie » En France, en comparaison, plus de 11000 mineures ont eu recours à l’IVG en 2002. Sur un total de 197400 IVG pratiquées en 1990 et de 205600 en 2002, respectivement 69000 et 79000 concernent les 15-24 ans.
En livrant ces chiffres, D. Serfaty [spécialiste français de la contraception] en appelle à la diversification des méthodes et, en particulier, à l’abandon des préjugés concernant le recours au dispositif intra-utérin (DIU).
En premier lieu, suggère-t-il, essayons de ne plus utiliser avec nos patientes le terme « stérilet », mais privilégions les dénominations de type « contraception intra utérine ou dispositif intra utérin ».
[D. Serfaty] rappelle que, d’après les recommandations de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), formulées en décembre dernier en collaboration avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), « les dispositifs intra-utérins ne sont pas uniquement destinés aux femmes ayant eu un ou des enfants. Il s’agit d’une méthode contraceptive de première intention très efficace... »
Commentaires : Rappelons aussi que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la nulliparité (autrement dit : le fait qu’une femme n’ait pas eu d’enfant), n’est pas une contre-indication au DIU même avant 20 ans ! [1]
Comme le rappelle Christian Rayr "le DIU a longtemps été regardé avec méfiance par rapport à quatre risques : infection génitale haute, stérilité, grossesse extra-utérine et douleurs pelviennes. Son compte-rendu fait le point sur chacun de ces risques.
Risque infectieux :
Ce ne sont ni l’âge ni la parité, mais les infections sexuellement transmissibles (IST) qui sont le premier facteur de risque d’infection génitale haute (IGH). L’OMS estime que deux tiers des IST touchent les adolescents et les jeunes. C’est chez les moins de 25 ans que le risque d’IST est le plus important et c’est dans cette même tranche d’âge qu’il y a le plus de nullipares.
Une étude (Struthers) montre que le risque infectieux lié au DIU est équivalent chez les nullipares et les multipares (femmes ayant eu plusieurs enfants).
Autrement dit : il n’est pas plus "risqué" de porter un DIU quand on n’a pas eu d’enfants que lorsqu’on en a eu plusieurs.
D’après une autre étude (Mishell), la fréquence du risque d’infection génitale haute lors de la première année d’utilisation du DIU est de 0,3 %.
Autrement dit : 3 infections sur 1000 femmes porteuses d’un DIU. Ce qui est très faible.
Enfin, d’après l’IPPF en 2003, en présence d’un examen préalable approprié, d’un faible risque d’IST et d’un DIU inséré selon une technique correcte, le risque d’IGH ne dépasse guère 1 pour 1000 : les IGH apparaissent le plus souvent dans les quatre semaines qui suivent la pose du DIU et sont dues dans la plupart des cas à l’introduction de micro-organismes durant l’insertion.
Commentaire : la plupart des infections sont dues à une erreur de pose, ou à l’introduction au cours de la pose d’un microbe dans la cavité vaginale, non traité . La meilleure prévention de ces infections rares consiste donc, pour la femme, à signaler au médecin, avant la pose, tout symptôme évocateur d’infection (saignement inexpliqué, pertes vaginales anormales ou inhabituelles) et, pour le médecin, à pratiquer un prélèvement à la recherche d’une infection locale puis, le cas échéant, à traiter cette infection.
Conséquence simple de cette notion : moins on touche à un DIU (moins on le change), mieux ça vaut - puisque les infections ont surtout lieu au moment de la pose !!! Cela devrait donc inciter les gynécologues à changer moins souvent les DIU au cuivre de leurs patientes. Rappelons que les DIU au cuivre peuvent être laissés en place bien au-delà de la date théorique indiquée sur leur notice. Ainsi, le TT 380 (le DIU qui porte du cuivre sur ses trois branches) est agréé, aux USA, pour être laissé en place 12 ans !!! Le seul DIU au cuivre qui devrait être changé au bout de 3 ans est le Nova T. Mais en toute bonne logique, les gynécologues français ne devraient plus le poser du tout...
Autre conséquence importante : si on doit retirer un DIU pour en mettre un autre à la place (DIU au cuivre contre un Mirena, ou l’inverse), les deux gestes doivent, sauf exception, toujours avoir lieu au cours de la même consultation !!!
Risque infectieux (suite) :
Résumant 12 grandes études de cohorte (études portant sur plusieurs centaines ou milliers d’utilisatrices) , Farley conclut à l’absence d’augmentation du risque infectieux pelvien au-delà de 20 jours après l’insertion du DIU.
Le Centre des maladies infectieuses d’Atlanta aboutit aux mêmes conclusions. Les études expérimentales montrent une prolifération microbienne juste après la pose, avec une disparition rapide en trois à quatre semaines.
Il peut y avoir aussi des différences d’un DIU à l’autre : une étude d’Andersson montre un taux cumulé inférieur de risque infectieux avec Mirena (DIU hormonal). Avec ce DIU, le taux cumulé brut de retrait sur 5 ans est de 0,8%, contre 2,2 % avec le Nova-T .
Autrement dit : au bout d’une année, 8 femmes sur mille ont fait retirer leur Mirena, contre 22 femmes sur 1000 - trois fois plus - qui ont fait retirer leur Nova T. Ce qui indique que les complications infectieuses à la pose sont un peu plus fréquentes avec un DIU au cuivre qu’avec un Mirena.
Étudié par Suhonen [en comparaison] avec la pilule chez des nullipares de 18 à 25 ans, le taux de continuation de Mirena après un an est par ailleurs de 79,8 % versus 72,7 %...
Autrement dit : Sur 1000 utilisatrices de Mirena, 798 l’utilisent encore au bout d’un an, contre 727 uutilisatrices de pilule. Ce qui signifie que les utilisatrices de DIU (le Mirena, en l’occurrence) restent plus fidèle à leur DIU que les utilisatrices de pilule à leur pilule...
L’inconvénient principal [du Mirena] est une pose parfois plus douloureuse, qui peut être améliorée par une technique rigoureuse. [2] La même étude observe que ce DIU entraîne une amélioration spécifique des dysménorrhées et des saignements menstruels lorsqu’ils existaient auparavant.
Autrement dit : pour les femmes qui avaient des règles abondantes et douloureuses l’utilisation d’un Mirena rend les règles moins douloureuses et moins abondantes. Pour ces femmes, le DIU Mirena est thérapeutique !!!
Risque d’infertilité :
Le compte-rendu de Christian Rayr poursuit :
Les études prospectives de cohorte ne mettent en évidence aucun problème de fertilité chez les anciennes utilisatrices de DIU. Le retour à la fertilité est aussi rapide qu’avec les autres méthodes contraceptives. Une étude de Hubaker, datant de 2001, ne trouve aucune augmentation du risque d’infection tubaire chez les nullipares, mais confirme la corrélation entre l’infection génitale haute et la présence de Clamydiae.
Commentaire : Un certain nombre de stérilités féminines sont dues aux infections gynécologiques hautes (infection des trompes, en particulier). Les trompes sont les canaux situés entre ovaires et utérus, où les spermatozoïdes rencontrent et fécondent les ovocytes ; lorsque les trompes sont infectées, elles s’abîment, et si les infections se répètent ou sont mal soignées, elles laissent des cicatrices dans les trompes. La circulation des cellules de la reproduction est donc compromise.
Les femmes dont les trompes ont été abîmées par une infection ont plus de difficulté à être enceintes, ou font des grossesses extra-utérines (GEU) : après fécondation, l’oeuf doit en principe se déplacer jusqu’à l’utérus pour s’y développer. Dans une trompe abîmée, il reste en place et, lorsqu’il atteint une certaine taille, distend la trompe et provoque une hémorragie. Ce que dit l’étude de Hubaker citée ci-dessus, c’est que ce n’est pas la présence d’un DIU qui favorise les infections ou les GEU, mais, bien sûr, la présence de microbes agressifs : les Clamydiae. Comment attrape-t-on des Clamydiae ? En ayant des rapports sexuels avec un partenaire infecté.
Rappelons ce qui est dit plus haut : ce qui provoque des complications infectieusesz, ce n’est pas le DIU, ce sont les partenaires sexuels... qui sont porteurs d’IST (infections sexuellement transmissibles).
Donc, pour éviter les infections, il faut
– soit s’assurer que son partenaire ne transmet pas de MST
– soit utiliser des préservatifs EN PLUS de la méthode contraceptive choisie, qu’il s’agisse de la pilule, d’un DIU ou d’un implant.
Grossesse extra-utérine :
En colligeant 42 études, Sivin met en évidence une diminution du risque de GEU chez les utilisatrices de DIU par rapport aux femmes n’utilisant pas de contraception. Ce mode de contraception exerce donc un rôle protecteur.
Commentaire : VOus avez bien lu : les DIU PROTEGENT contre les GEU, ils ne les provoquent pas. Démonstration :
La première cause favorisante de GEU, c’est le fait d’avoir eu au préalable une infection des trompes. Mettons que la proportion de femmes ayant eu une infection des trompes soit de 1% dans la population générale :
– parmi 1000 femmes enceintes sans contraception, il y aura au cours d’une année 850 grossesses [3] ; sur ces 850 grossesses il y aura 1% de GEU = 8,5.
– sur 1000 femmes porteuses d’un DIU, il y aura 10 grossesses (les grossesses sur DIU au cuivre sont de l’ordre de 1%) ; sur ces 10 grossesses, il y aura 1% de GEU... c’est à dire 0,01...
Donc, l’utilisation d’un DIU, au cuivre ou hormonal, PROTEGE contre les GEU.
Oui, me dira-t-on "mais pas plus que la pilule !"
Eh bien si, car les grossesses accidentelles chez les utilisatrices de pilule sont 2 fois plus nombreuses que les grossesses accidentelles chez les utilisatrices de DIU.
Attention, cependant, tous les DIU n’ont pas la même efficacité !!!
Douleurs pelviennes [4] :
Plusieurs auteurs recommandent, chez les nullipares, de ne pas se limiter aux antalgiques [aspirine, paracétamol] et à l’antispasmodique le plus prescrit ([spasfon]) qui n’a pas d’activité démontrée sur les douleurs, mais de recourir au misoprostol 3 heures avant l’insertion, voire à certains anti-inflammatoires non-stéroïdiens...
Autrement dit : avant de poser un DIU à une femme sans enfant, le gynécologue ou le généraliste peut prescrire du misoprostol (un médicament qui dilate l’entrée de l’utérus) ou des anti-inflammatoires (ibuprofène, en vente libre). Bref, la pose d’un DIU peut se faire avec très peu de désagrément, même chez les femmes sans enfant.
Lorsque les femmes ont, hors de toute contraception, des règles douloureuses, le DIU hormonal diminue les douleurs. Les DIU au cuivre, eux, ne les modifient pas. Les utilisatrices de DIU au cuivre qui ont des règles douloureuses peuvent parfaitement utiliser des anti-inflammatoires pour calmer ces douleurs. Car, contrairement à ce qu’on prétend encore en France, les anti-inflammatoires n’ont aucun effet sur l’efficacité des DIU.
Et le compte-rendu de Christian Rayr conclut :
Pour sa part, D. Serfaty [spécialiste français de la contraception] estime qu’il faut réserver une place au DIU chez les nullipares :
– 1° en contraception d’urgence pour les DIU au cuivre ;
– 2 dans les contre-indications à la contraception orale ;
– 3° en cas de problème d’observance avec la pilule ou lorsque les implants, patchs et anneaux vaginaux ne sont pas souhaitables ou acceptés ;
– 4° en présence d’un partenaire stable chez les femmes de plus de 20 ans bien informées et souhaitant la pose d’un DIU ;
– 5° en excluant de toute manière les femmes à haut risque d’IST et en insistant sur la double protection.
Commentaires : En pratique, une femme ne peut choisir sa contraception que lorsqu’on l’a bien informée, autrement dit, si on lui a donné TOUTES les informations sur TOUTES les méthodes. Et surtout si les informations sont scientifiquement valides. D’où la nécessité pour les médecins de se mettre à jour de leurs connaissances et de répondre précisément aux questions des femmes.
De sorte que lorsqu’une femme opte pour le DIU, comme pour toute autre méthode, elle la choisit en connaissance de cause. Dans la réalité, les femmes refusent souvent le DIU parce qu’elles pensent que c’est dangereux pour elles. Quand on leur explique que ça ne l’est pas, beaucoup choisissent d’essayer. Et, comme le disent les chiffres ci-dessus, celles qui choisissent un DIU restent fidèles à cette contraception plus souvent que celles qui prennent la pilule...
Extraits d’un compte-rendu du 4e congrès de la Société francophone de contraception (Bâle, 15-16 avril 2005) rédigé par Christian Rayr et publié en juin sur la newsletter professionnelle du site "Gyneweb" (site de gynécologues français)
Commentaires : Martin WInckler
[1] A titre personnel, je peux témoigner avoir posé sans incident pour elles des DIU à des nullipares de moins de 20 ans au cours des 10 dernières années. Celles qui, au bout de quelques années, ont demandé le retrait du DIU pour avoir des enfants ont mené leur(s) grossesse(s) à terme sans problème.
[3] Car on estime qu’une femme fertile n’utilisant aucune méthode contraceptive a 85% de chances d’être enceinte dans l’année
[4] Douleurs au bas-ventre au moment des règles

Imprimer
|