|
|
Courriers et contributions >
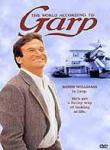 Vocation
Vocation
Les films pour enfants n’existent pas
par Sandra Maor
Article du 23 février 2004
Qui dit qu’il ne faut jamais parler que de sujets graves ou tragiques ?
Il n’y a pas très longtemps, dans un café, à Bruxelles, Sandra Maor, avec qui j’échangeais déjà des courriers électroniques depuis longtemps, mais que je rencontrais pour la première fois, m’a raconté son histoire d’amour avec le cinéma. Je lui ai dit que cette histoire méritait d’être partagée, et je l’ai invitée à la mettre sur le papier. Elle vient de me l’envoyer. La voici.
Mar(c)tin W.
D’habitude je n’écris pas de récits autobiographiques, du moins, pas de récits dans lesquels je raconte directement des événements qui me sont réellement arrivés, en les présentant comme tels. Si autobiographie il y a dans mon écriture, c’est alors celle des émotions, des pensées vécues, ressenties ou imaginées chez moi ou chez les autres, insérées dans du fictionnel, le tout mixé suffisamment pour que l’on ne puisse pas distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas.
J’ai toujours pensé que j’avais besoin de cette traduction par l’imaginaire, de ce filtre opaque ou translucide, non seulement pour protéger mon intimité, mais aussi pour trouver de l’amusement, du plaisir dans l’écriture : où serait le plaisir à écrire une histoire que je connaîtrais déjà ? On pourrait me rétorquer : " quel plaisir as-tu à te raconter oralement ? " et je ne saurais pas quoi répondre car si j’écris maintenant ce texte, c’est précisément parce que j’ai raconté mon histoire à Mar(c)tin qui m’a ensuite suggéré de l’écrire.
S’il m’a fait cette suggestion, je suppose que c’était parce qu’il avait eu du plaisir à l’écouter et par conséquent que j’avais eu du plaisir à la raconter et donc mon principe ne tient plus (comme la plupart des principes d’ailleurs) ou du moins la partie " plaisir " de sa justification. La partie " protection de mon intimité " reste valable, mais je peux peut-être faire une exception pour ce récit...
L’histoire que Mar(c)tin m’a suggéré d’écrire est celle de la naissance de mon amour précoce pour le cinéma. Il souhaitait surtout que je raconte que voir des films destinés aux adultes à un âge où je n’en étais pas encore une, n’avait pas fait de moi une folle à l’âge de trente ans (cette dernière affirmation n’engage que lui et il y aura peut-être des gens qui ne seront pas de son avis).
La première fois que j’ai vu un film dans une salle de cinéma, j’avais deux ans et demi et, jusque là, rien d’original : c’était le " Pinocchio " de Walt Disney. J’avais été tellement fascinée que je m’étais tenue tranquille pendant toute la durée du film, assise sur les manteaux de mes parents pour voir au-dessus des têtes des grands, les yeux rivés sur l’écran, absorbée par les images qui dansaient et chantaient, alors que l’immobilité m’était d’habitude une torture.
Quand mes parents m’emmenaient au parc, par exemple, ils passaient leur temps à courir derrière moi d’un endroit à l’autre, de peur de me perdre de vue. Tout en me poursuivant, ils s’étonnaient de voir autant de bébés placidement assis sur leurs couvertures et ils se disaient " ah, si elle pouvait être un peu comme ça ", pour ensuite rejeter cette idée finalement déplaisante : " non, avec elle, c’est plus fatigant, mais c’est aussi plus amusant ". Avec moi, comme au cinéma, c’était le spectacle permanent. Pourtant, dans les salles obscures, je restais scotchée à l’écran et mes parents prirent donc l’habitude de m’emmener avec eux même s’ils allaient voir un Woody Allen en V.O sous-titrée ou le dernier James Bond.
A chaque fois, la magie opérait sur mon petit être et je ressortais toute excitée de ce lieu magique ou des O.V.N.I. atterrissaient sur l’écran de lumière pour nous ensorceler. Si j’ai si rapidement attrapé le virus du cinéma, c’est que j’étais déjà atteinte par celui des histoires, celui de la fiction, tendrement inoculé via les livres qu’on me lisait le soir pour m’endormir pendant que j’étais le maître du temps, imposant mon petit, mon moyen et mon grand rond de lectures, mes unités temporelles très personnelles et m’énervant de ce que mes parents, -qui étaient pourtant des adultes qui auraient dû par ce fait même tout savoir- ne comprenaient pas à quoi cela correspondait.
C’était pourtant évident : un petit rond, un moyen rond et un grand rond, c’est du temps qui passe, ça se voit dans la tête et ça correspond à... à... à un petit rond, un moyen rond et à un grand rond. C’est clair non ?
Au cinéma, pas besoin de mes notions temporelles très personnelles : l’image apparaît par magie quand les lumières s’éteignent et s’écoule de manière ininterrompue jusqu’à ce que l’on rallume.
Tout au long de mon enfance, l’arrivée progressive de l’obscurité fut le signal pour incanter en coeur nos paroles magiques : " ça commence ! ça commence ! " (à susurrer sur un ton plein d’excitation et de bonheur), avec parfois la variante : " c’est le film ou c’est encore des publicités ? ", variante toutefois déconseillée car cassant un peu la féerie de la formule ; mieux vaut se contenter du " ça va commencer " quitte à devoir le réitérer en cas de fausse alerte. C’est peut-être cet absence de contrôle sur le temps qui me faisait voir les films comme des O.V.N.I et qui me fit prendre conscience seulement très tardivement de la présence d’être humains dans la fabrication des films alors que j’ai toujours su qu’il y avait des écrivains derrière les livres.
Cette fascination pour le medium cinématographique qui opérait même pour les films qui n’étaient pas destinés à un public de mon âge me permit d’entrer très vite dans le monde des émotions adultes, de questionner les sentiments qui m’étaient encore étrangers et accessoirement de réaliser un jour que je parlais anglais sans jamais l’avoir appris scolairement. En sortant du cinéma, les films devenaient des lieux d’échange, la découverte se poursuivait par le dialogue.
Je trouvais fascinante l’étendue des émotions humaines, ces gens qui sur l’écran agissaient selon des instincts que je ne comprenais pas et ceux auxquels je m’identifiais. Les films m’aidaient à grandir, à découvrir ce monde étrange des adultes, à inventer ma vie.
Le premier film " pour adulte " qui m’a vraiment marquée quand j’étais enfant, le premier que j’ai vu avec à peu près les mêmes sentiments que lorsque je le revois aujourd’hui, c’était " Le monde selon Garp " de George Roy Hill, d’après un livre de John Irving. Ce film m’avait enchantée et pourtant, je ne voulais pas entrer dans la salle quand ma maman et un ami à elle m’y emmenèrent. Les photos du film ne m’inspiraient pas, je boudais, voulais aller voir autre chose. Ils n’ont pas cédé et j’ai tellement adoré le film que j’ai accepté de mettre mon orgueil de côté pour l’admettre et supplier d’y retourner.
On pourrait penser qu’un film où un homme perd son organe sexuel parce qu’il est en train de se faire sucer dans une voiture quand une autre voiture lui rentre dedans n’est pas un film pour un enfant de huit ans et l’on n’aurait pas entièrement tort. Toutefois, il ne faut pas généraliser. Premièrement, la phrase où Roberta, le transsexuel dit " oh le pauvre, moi au moins on me l’a enlevé sous anesthésie ! " me faisait déjà beaucoup rire à l’époque et puis, surtout, c’était LE film dont j’avais besoin, qui était là pour apaiser mes peurs, pour que j’y retrouve mes angoisses, c’est le film qui m’a aidé à grandir en alimentant mon imaginaire.
Garp n’avait pas de père et j’avais perdu le mien. Tous deux nous fantasmions notre père vivant, nous le fantasmions à l’autre bout du monde amnésique (dans mon cas) ou comme Lone Ranger qui n’était pas vraiment mort quand tout le monde le croyait mort (dans le sien), tous deux nous avions des mères qui nous enseignaient que la vie est belle malgré tout, que cela peut être une aventure merveilleuse et qu’il faut chercher à réaliser ses rêves. Je m’identifiais complètement à cette histoire et cela me faisait beaucoup de bien. Mais je conviens qu’elle n’est pas adaptée à tous les enfants.
La preuve en est que pour la troisième fois où ma mère m’emmena voir le film, une de mes amies nous accompagna et... ressortit traumatisée. Elle pleurait, sanglotant que Garp était mort et que c’était injuste. J’avais un sourire radieux et j’essayais de lui expliquer qu’il allait peut-être mourir en effet mais qu’il y avait plus important : on l’emmenait en hélicoptère et il réalisait donc enfin son rêve de voler, ce qui était merveilleux. Il le disait lui-même (en ôtant le masque respiratoire) : " I’m flying, Helen, tadaaam, tadaaam, I’m flying... ". Deux visions totalement opposées du même film.
Personnellement, c’est Bambi qui m’avait traumatisée, à peu près au même âge. Comme quoi... Dans mon souvenir du film, Bambi avait perdu sa maman et son père mourait ensuite dans un incendie. Mon père était déjà mort lui aussi et le film m’inspira pendant trois ans des cauchemars d’incendie où ma maman périssait à son tour, comme si le message du film était que lorsque vous n’aviez plus qu’un de vos parents, le deuxième devrait y passer prochainement.
Mar(c)tin m’a raconté qu’en réalité, dans Bambi, seule la mère meurt (je n’avais jamais osé revoir le film pour vérifier). Mon esprit d’enfant avait donc fait quelque part un amalgame, une passerelle entre la mort de la mère et l’incendie dont le père réchappe. Mar(c)tin m’a également appris que ce qui est violent dans ce film, c’est que Bambi se fait tout de suite arracher à sa mère morte par son père qui veut le protéger des chasseurs et qu’il n’avait donc pas eu la possibilité de faire son deuil.
Alors, c’est peut-être cela, qui m’a fait superposer la mort de la mère et l’incendie, cette absence de temps de deuil. Cela expliquerait pourquoi Bambi m’a traumatisé alors que Garp m’a aidée : Garp peut faire ce travail là, il peut parler de son père défunt qu’il n’a pas connu, il peut avoir des réponses à son sujet (même si sa mère elle-même ne sait pas grand-chose), il peut le fantasmer vivant puis l’admettre mort. Je faisais le même voyage aux côtés de Garp, pour réaffirmer que la vie serait merveilleuse, même en l’absence de mon père.
Je pense donc qu’il n’y a pas de cloison à faire entre les films pour enfants et les films pour adultes. Les gens de l’équipe Pixar l’ont d’ailleurs bien compris, truffant leurs films soit disant pour enfants de références intertextuelles uniquement décelables par les adultes. Etablir une frontière parmi les films, c’est un peu comme considérer qu’il y a des jouets pour filles et d’autres pour garçons, par exemple et qu’un petit garçon ne peut pas jouer avec une poupée. Dans les films, comme dans les jouets, chaque personne peut trouver son bonheur et celui-ci ne peut pas se résumer à une formule standardisée déduite du sexe, de l’âge et d’autres normes ou statistiques.
D’autant que les chiffres et les classements n’intégreront jamais les dialogues que les parents auront ou n’auront pas eu avec leurs enfants autour des films... et qu’en emmenant leurs enfants au cinéma avec eux voir des films " pour grands ", les parents font à leurs rejetons un des plus beaux cadeaux : celui consistant à les accepter dans leur monde, à admettre qu’il n’y a pas de frontière rigide, à les traiter en égaux.
Tant que j’en suis à parler de mon rapport aux histoires, je voudrais dire qu’il me semble que si le pouvoir des livres (ou des films) est si fort, c’est parce qu’ils nous apportent deux des choses les plus importantes pour passer un cap difficile : l’imaginaire et la connaissance. Je pense que ce n’est pas innocent si lorsque mon père luttait contre la leucémie à l’hôpital, je me suis plongée dans mes livres d’enfant, au point d’apprendre toute seule à les lire : je me réfugiais dans le réconfort du savoir (j’apprenais à lire) et dans le réconfort de l’imaginaire (je me plongeais dans la fiction).
Ce réflexe d’un enfant de cinq ans pour se protéger contre l’inconnu de la maladie de son père, me semble un bel exemple du pouvoir des mots et des histoires, qui nous accompagnent aussi bien lorsque nous sommes joyeux que lorsque nous passons un cap difficile, qui peuvent nous aider à rebondir, nous faire découvrir de nouveaux horizons.
J’aurais encore des tas d’histoire à raconter sur les films et livres de mon enfance, mais il me semble que pour un premier essai d’écrit non fictionnel, c’est déjà pas mal. Ceci dit, la boucle est bouclée : dans mes récits fictionnels se cache de l’autobiographique, mais dans ce récit autobiographique, se cache aussi du fictionnel : la part de mythification des souvenirs, la part du récit dont on ne sait plus exactement si l’on s’en souvient réellement ou si l’on se souvient uniquement de l’avoir déjà raconté ou entendu raconter. Ce qui reste du fait de base en est-il l’épure, l’essence même ou au contraire l’écume, les remous qui masquent la vérité ? Après tout, cela n’a pas d’importance, car c’est cette fiction de la vérité qui est restée ancrée en moi et qui pour moi dit le vrai.
(c)Sandra Maor, 2004

Imprimer
|



