|
|
Les médecins, les patients, et tout ce qui s’ensuit... >
Chroniques carabines >
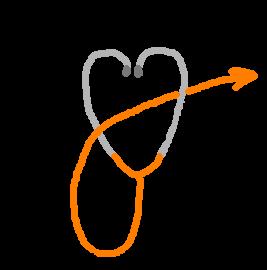 Chroniques Carabines, 6
Chroniques Carabines, 6
Il n’y a pas d’amour
par Scarabée
Article du 2 septembre 2010
Il n’y a pas d’amour. Certains adultes y croient encore, surtout des femmes seules qui pensent pouvoir partager cette sensation avec un autre être humain et finissent généralement par opter pour un chien de petite taille. Les autres se sont pris tellement de gamelles qu’ils songent sérieusement à raccrocher les gants. Souvenez-vous, vos vies n’ont pas toujours été aussi moches. A l’adolescence par exemple, lorsque vous étiez naïfs mais pas encore rances.
L’adolescence est pour moi la période la plus lucide de la vie, celle où la lâcheté n’a pas encore pris le dessus. Souvenez-vous de l’euphorie de vos quinze ans : vous avez découvert que vous disposiez d’un coeur non uniquement assimilable à une pompe à ketchup. Cette révélation a même suffi à vous faire oublier que par la faute d’un véto parental définitif, vous n’auriez pas les cheveux bleus pour votre rentrée en seconde. Pendant une parenthèse enchantée de quelques années, vous avez osé lever les yeux de votre nombril ; la souffrance ne vous effrayait pas, pourvu que vous puissiez goûter encore et encore à ce fruit exotique.
Vos parents vous regardaient vous agiter dans tous les sens en faisant du bruit, déjà blasés, n’osant pas vous dire que passée cette brève période où personne ne craint le ridicule, le rideau se referme, les quidams se renferment et les sentiments perdent leur incandescence. Les plus valeureux soufflent encore un peu sur les braises à trente piges, et pour finir, il ne reste que de la cendre dans le coeur des quadra. L’adolescence, c’est le jardin de la Création ; les jeunes Adam et Eve y dénudent allègrement leurs coeurs, puis un jour le Serpent leur annonce qu’ils se sont mis à poil. Alors tout le monde remballe, honteux, et file se construire une jolie petite carapace.
A l’hôpital comme à l’extérieur, il n’y a pas d’amour. D’abord, on n’est pas formé pour, disent les pragmatiques. Est-ce que ça s’apprend, l’amour ? Je ne pense pas. On peut apprendre à le révéler, à le dégager des gangues dont il est prisonnier, mais pas le créer de toutes pièces. J’ai longtemps cru que le personnel médical dans sa majorité ressentait bien quelque chose mais refoulait ses émotions pour ne pas trop en souffrir ; l’histoire que je m’en vais vous conter m’incite plutôt à croire que plus personne n’éprouve rien. Ou alors, c’est vraiment bien planqué, et y’a intérêt à trouver un putain de soufflet pour raviver tout ça.
Un jour de visite comme les autres. Le chef de service, la chef de clinique, les internes, les externes passent de chambre en chambre. On arrive finalement à la deux. Le client du jour est un monsieur de 50 ans et quelques, qui a posé son baluchon chez nous depuis une ou deux semaines. C’est un habitué : il souffre depuis 5 ans d’une de ces maladies dégénératives absconses dont seule la neurologie sait nous régaler. Personne n’y comprend rien, et chaque fois que les rois du service se penchent sur son cas, la confusion règne. Tout a commencé par une atteinte du cervelet, le « petit cerveau » qui mène à bien la coordination des mouvements. Puis il est devenu sourd. Ses implants auditifs ont fonctionné un certain temps, mais aujourd’hui ils ne servent plus qu’à projeter deux grandes ombres genre oreilles de mickey sur son imagerie cérébrale. Depuis quelque temps, on ne communique plus avec lui qu’au moyen d’une ardoise et d’un feutre Velleda. Sa voix a elle aussi subi des modifications détestables : on dirait un enfant de 13 ans qui mue.
Il est coincé dans son lit, tremblotant, prisonnier de son corps, totalement dépendant de ses braves parents octogénaires qui l’ont repris à la maison, en province. Physiquement, c’est une ruine ; mentalement, tout est intact. C’est un spectacle déjà dur à voir en temps normal ; mais aujourd’hui, lorsque nous nous massons de chaque côté de son lit, je sens qu’il y a autre chose. Le patient se balance d’avant en arrière, genoux repliés, tête rejetée, rouge et soufflant comme s’il allait pleurer. Il m’évoque aussitôt les orphelins roumains que j’ai vu en convoi humanitaire se bercer de la sorte. Il en a gros, c’est manifeste. Mais pas suffisant pour que la visite s’arrête.
Un terrible ping-pong médical commence au-dessus de son lit, entre le chef de service et la chef de clinique, avec le patient pour filet :
Tic « Qu’est-ce qu’on fait ? »
Toc « Je ne sais pas trop, avec les implants sur l’IRM on voit que dalle en plus. »
Tic « Alors on lui enlève ? »
Toc « Faut voir...et est-ce qu’on lui refait une ponction ? »
Et nous, les externes, le public de cette rencontre au sommet, nous restons là, sans mot dire, comme toujours...
Soudain le monsieur se redresse un peu sur son lit et crie de sa voix d’enfant, un feulement à fendre l’âme : « C’est normal que j’entends plus rien du tout ? »
J’ai mal d’entendre cette voix, d’y entendre l’effarement d’un tout-petit qui ne maîtrise rien, qui veut juste que ça s’arrête, que quelqu’un l’aide, lui parle, le rassure à la fin, quand tout ce qu’il voit ce sont ces blouses blanches qui ne s’arrêtent pas de parler, de parler entre eux mais certainement pas à lui qui n’entend rien... Mais la partie ne cesse pas, elle doit continuer, il faut un gagnant, les enjeux sont grands mesdames et messieurs...
Stupeur. Je jette un coup d’oeil à droite, à gauche, aux ramasseurs de balle et aux juges. Suis-je la seule à avoir entendu son cri d’angoisse ? Ou alors, tout le monde s’en fout ? Est-ce plus important de faire le diagnostic d’une maladie pourrie qu’on ne pourra de toute façon pas soigner ?
La rage monte en moi. Ils ne peuvent pas n’avoir pas entendu. Ca ne les intéresse pas. Je fais quelques pas pour attraper l’ardoise posée sur la desserte et je viens me placer à la tête du lit. Je griffonne « C’est ce dont ils discutent justement ». Je n’ai rien de plus rassurant. Moi aussi, je suis à poil. Lorsque je reviens à ma place, l’interne me demande aussitôt ce que j’ai écrit. La parano médicale. Des fois que l’externe ait eu l’idée de dire au patient qu’il allait crever ; mieux vaut vérifier.
La partie finit par prendre fin. J’ai oublié les scores, le gagnant. Tout ce que je ressasse en sortant de la chambre, c’est que personne n’a rien fait. J’ai bien du essayer d’en parler à mes co-externes de retour dans le bureau. Aucun n’avait entendu, si mes souvenirs sont bons. Il devrait y avoir dans les hôpitaux un gueuloir, une petite pièce complètement insonorisée dans laquelle soignants et patients pourraient venir hurler leur rage, leur désespoir, leur incompréhension. Mais il n’y en a pas. Il n’y a que des chambres petites et moches où ravaler ses larmes.
Etres humains qui passez par ici, dites-moi que vos braises ne sont pas éteintes, que sous les multiples couches de la carapace que vous avez du vous forger, quelque chose palpite encore, que votre coeur enfle encore parfois comme un nuage, comme un soufflé. Que si je m’acharne à la masse sur les armures de ceux qui comptent, j’ai une toute petite chance d’en libérer des émotions vraies. A l’hôpital ou ailleurs.
Pour écrire à Scarabée

Imprimer
|



